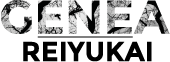A la lumière d’une vie ordinaire
Henri A, mon grand-père maternel, est né en 1912, dans une famille de cultivateurs vendéens très modestes. Son père, Eugène A, est décrit par mes oncles comme un homme placide et « bonhomme ». Sa mère, Marie M, est décédée peu de temps avant son fils aîné, tous deux frappés par l’épidémie de tuberculose qui avait contraint la famille à mettre la maison en quarantaine. Durant cette période, mon grand-père et les siens furent considérés comme des pestiférés. Privé jeune de sa mère, Henri dut vite apprendre à affronter seul l’âpreté de cette existence rurale. Mes souvenirs de lui sont très rares, lointains, impersonnels. Je le revois au milieu d’une grande tablée à l’occasion des repas familiaux. Austère, rude, triste.
« cette tristesse si familière à laquelle j’avais cru pouvoir me dérober en partant. »
J’ai réellement appris à le connaître en 1997, quelques mois après avoir commencé à pratiquer. Cette année-là, je me suis vu proposer un poste de lectrice en Hongrie, où je suis allée m’installer pour un an. Assez vite, j’ai retrouvé là-bas cette tristesse si familière à laquelle j’avais cru pouvoir me dérober en partant.
un rêve inspirant
Je me suis donc remise à réciter le soutra. Or, une nuit, j’ai rêvé de ma grand-mère maternelle. Chronologiquement me sont apparus différents moments de sa vie et j’ai éprouvé les états intérieurs qui étaient les siens à ces époques : je l’ai rêvée enfant quand tous les possibles sont ouverts, adolescente lorsque se pose le choix de poursuivre ou non des études supérieures, jeune adulte influençable réduite à travailler aux champs parce que découragée par son entourage de devenir institutrice, mère, dépossédée par sa sœur de son rôle de maîtresse de maison, grand-mère, vidée de sa personnalité propre, transparente, fantomatique, incapable d’établir un lien avec ses petits enfants. Le lendemain, j’apprenais qu’elle était décédée au cours de la nuit. Je ne pouvais matériellement me rendre à sa sépulture . En revanche, inspirée par l’enseignement du Soutra, j’ai écrit quelques lignes que l’un de mes frères a lues lors de l’office religieux.
un lien se tisse
En retour, mon grand-père, qui ne m’avait jamais appelée, a pris son téléphone et nous avons appris à nous connaître, lui de la maison de retraite où il vivait désormais, moi de ma chambre, perdue au plus profond de la campagne hongroise, à 1500 km de lui. Qu’ai-je appris ? Combien, par-delà mes idées, les écarts de générations, les degrés d’instruction différents, nous étions semblables. Ce soir-là, nous avions le même âge. A intervalles réguliers, il m’a appelée, nous avons parlé de sa vie et un lien s’est tissé. Mon grand-père, comme beaucoup de gens de sa génération et de son milieu, n’a pas pu réaliser l’existence qu’il souhaitait. Reçu parmi les premiers de sa commune au certificat d’études, il n’a pourtant guère pu poursuivre l’école au-delà de ses 12 ans. Très vite, il a dû en effet travailler dans la petite ferme familiale.
des coïncidences étonnantes
Le service militaire occasionna le premier voyage et le conduisit à Angoulême, à quelques centaines de mètres de l’endroit où je vis aujourd’hui. Le terrain d’exercices militaires où il se rendit quotidiennement durant deux ans a changé aujourd’hui de fonction. Toujours baptisé « Champ de manoeuvres », ce lieu est à présent hérissé de nombreux immeubles, au milieu desquels se dresse un collège, celui où je travaille depuis bientôt 7 ans. Au retour des deux années de service militaire, Henri dut, en tant que fils cadet, chercher à se placer, la ferme parentale ne pouvant suffire à nourrir plusieurs familles. Il pensa partir s’installer en Charente. C’est alors qu’il entendit parler d’une « place à prendre » comme cultivateur, dans une commune voisine, chez un charron-forgeron qui avait une terre d’une petite dizaine d’hectares. La fille aînée était « épousable ». Ils se convinrent et se marièrent l’année suivante, le 3 février 1937. Comme c’était souvent l’usage à cette époque, mon grand-père s’installa chez ses beaux-parents, avec ses deux belle-soeurs qui ne se marièrent jamais. Il n’avait sans doute pas conscience à ce moment-là, lui l’accordéoniste autodidacte, qu’il pénétrait dans une maison fermée, froide, où l’on se tait, où l’on se couche tôt après le souper, où l’on ne se réjouit pas, où l’on ne joue pas de musique. Son beau-père, Pierre G, avait la moustache longue et « bon enfant ». Mais sa belle-mère était une femme pieuse et « cancanière », se méfiant des voisins et dont la peur du qu’en dira-t-on constituait l’axe moral. Sa belle-sœur la plus âgée, Marie, couturière inventive et talentueuse, était par ailleurs une « forte femme ». Mon grand-père racontait que même ses parents la craignaient « comme le feu sur la peau ». Aucun des prétendants qui demandèrent sa main ne trouva grâce à ses yeux. Bien après la mort de ses parents, elle fit donc régner son autorité sur toute la maisonnée, et sur ma grand-mère, dont elle était très probablement jalouse, en particulier. La sœur cadette de ma grand-mère, Madeleine, était, elle, depuis l’adolescence, soumise à de sévères crises de nerfs qui terrorisaient les enfants et qui lui valaient des séjours en hôpital psychiatrique, dont elle revenait « calmée », jusqu’à la prochaine secousse. Quels événements avaient conduit à l’éclosion de la folie chez cette jeune femme qu’on disait autrefois brillante écolière ? Deux générations plus tard mais au même âge, l’une de mes cousines fut confrontée à des troubles psychiques aussi profonds… Toujours est-il qu’Henri fut très probablement considéré comme un trublion, un semeur de désordre, lui qui voulait moderniser la ferme, y amener l’eau courante, et qui aimait faire un peu la fête au moment des battages…
l’expérience douloureuse de la guerre
Il fut mobilisé le 3 septembre 1939, ignorant alors qu’il partait pour 6 ans. Son 2ème fils devait naître un mois plus tard. Dans les écrits qu’il a laissés, il décrit l’itinéraire parcouru de la Vendée à la Prusse orientale. Il raconte comment, fait prisonnier en Belgique en mai 1940, il traversa, tantôt à pied, tantôt entassé avec beaucoup d’autres dans des wagons à bestiaux grouillant de poux, le Luxembourg, l’Allemagne, la Pologne, pour rejoindre le camp prussien d’Hohenstein. Il raconte encore les épluchures de patates bouillies en guise de souper, le froid, la faim, les levers à 4 heures au pas de course aux ordres des soldats, l’épuisement, la mort côtoyée, les relations humaines qui se tissent malgré tout durant près de 5 ans avec les fermiers allemands chez qui il doit travailler après avoir été « vendu comme du bétail ». Il parle enfin de la grand-mère allemande morte et enterrée en route tandis qu’ils fuyaient ensemble devant l’arrivée des Russes, du copain blessé par une balle qu’il porte sur son dos pour franchir à la nage un bras de mer Baltique…
une aspiration tue…
Il revint changé de cette expérience sans pouvoir la communiquer à quiconque. C’était la fin des moissons « on était trop occupé à rentrer les gerbes »pour fêter son retour. Je sais aussi que ses deux fils ne le reconnurent pas et se dirigèrent vers un autre qui portait l’uniforme militaire quand lui était en civil, que son beau-père vint le voir le soir pour lui signifier que « ce n’était pas le tout » mais que le lendemain des « vaches étaient à traire»… Le statut d’ancien prisonnier de guerre offrait alors la possibilité de devenir fonctionnaire. Il aurait pu devenir facteur et quitter la ferme avec femme et enfants sous le bras. C’était son vœu profond, il y pensa durant des mois mais jamais, par crainte de la réaction, il n’eut la force de le formuler à sa belle-famille. Combien de fois m’a-t-il exprimé son regret d’avoir manqué de courage ! Il était très conscient des effets de sa faiblesse. Cette décision avortée eut pour conséquence de laisser grandir ses quatre fils et ma mère, la plus jeune, dans une atmosphère tendue, pesante, neurasthénique, dont je ne sais pas tout. Comme il l’écrivit lui-même, « le petit train train reprit comme avant guerre. Il n’y avait eu aucune évolution. »
Un lien ininterrompu
Henri et Clarisse ne quittèrent la Bretonnière que bien des années plus tard pour s’installer à la maison de retraite. Ma grand-mère y mourut un an après y être entrée. J’entends encore parfois mes parents me parler de l’empressement à cette époque que les cinq enfants mirent à vendre la maison et à brûler tout ce qui s’y trouvait comme si, dans le brasier, ils allaient voir partir en fumée leurs mauvais souvenirs.
Je n’ai vu mon grand-père joyeux qu’à mon retour de Hongrie, dans sa petite chambre de la maison de retraite. Au cours de ses dernières années, il joua dans cette dernière un rôle actif, y créa des liens, trouva enfin, non sans en tirer un petit orgueil, un public à ses chansons et à ses airs d’accordéon …
Ma dernière rencontre avec lui remonte à la veille d’un séminaire, en novembre 2004. Il nous a confié alors, à David et à moi, qu’il sentait sa mort toute proche. Nous lui avons transmis quels efforts nous ferions pour qu’elle ne signe pas la fin de notre relation. Il voulut qu’on inscrive sur une feuille le nom de notre pratique et termina ainsi : « Je ne vous demande qu’une chose : d’avoir une petite pensée pour moi quand vous réciterez votre texte !» J’appris son décès à l’heure précise de la clôture du séminaire.
Depuis, 3 autres de ses petits enfants ont commencé à pratiquer et mes parents sont devenus sympathisants. Ils nous aident aujourd’hui très concrètement à réaliser notre but d’accéder à une humanité plus juste. Malgré la disparition de son corps, je ressens toujours la présence bienveillante de l’esprit d’Henri. J’éprouve aussi beaucoup de reconnaissance pour les qualités qu’il m’a léguées. Surtout, je perçois profondément le rôle qui est le mien de dépasser, par la merveilleuse pratique de bodhisattva, mes propres obstacles.